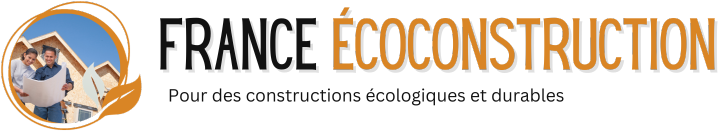Pendant longtemps, les adoucisseurs d’eau au sel étaient considérés comme la norme. Aujourd’hui, il y a également les adoucisseurs d’eau au CO2 qui fonctionnent différemment des adoucisseurs d’eau au sel. Lorsqu’il s’agit de choisir une solution pour adoucir l’eau de son habitation, un problème de choix se pose rapidement. Cet article analyse les avantages et les inconvénients de chacun afin de vous aider à choisir l’adoucisseur d’eau qui vous convient le mieux.
Avantages et inconvénients de l’adoucisseur d’eau au sel
Un adoucisseur d’eau au sel permet de traiter l’eau par un procédé chimique afin d’éliminer le calcaire et le tartre qui se trouvent dans l’eau. Pour perdre sa dureté, l’eau passe à travers un échangeur d’ions qui remplace les minéraux (calcium et le magnésium) responsables de la dureté d’eau, par des ions sodium.
Même si ce système fonctionne bien, il présente un certain nombre d’effets inconvénients pour les installations, pour la santé, mais aussi pour l’environnement. L’adoucisseur d’eau au sel demande une régénération avec de l’eau claire, par conséquent une consommation excessive d’eau. L’adoucisseur au sel utilise des sacs de sel polluants pour son processus de régénération et gaspille des centaines de litres d’eau par an pour s’auto-nettoyer.
D’un autre côté, un adoucisseur d’eau au sel a besoin d’un entretien régulier à cause de l’eau qui est accumulée dans la résine et qui augmente les risques de pollution. En réalité, après la régénération du système, l’eau saturée est rejetée dans les égouts.
Par ailleurs, l’adoucisseur d’eau au sel dénature l’eau en transformant son goût et ses propriétés. À vrai dire, les ions calcium et magnésium ne sont plus présents dans l’eau adoucie par le sel. Cela altère donc le goût de l’eau parce que ces minéraux ont été remplacés par les ions sodium.
Avantages et inconvénients de l’adoucisseur d’eau au CO2
Un adoucisseur d’eau au CO2 est un dispositif qui utilise le CO2 alimentaire pour réduire la dureté de l’eau. Le CO2 injecté dans l’eau transforme le calcaire en bicarbonate de calcium et de magnésium. Ainsi, l’adoucisseur d’eau au CO2 n’élimine pas le calcaire présent dans l’eau, mais le dissout plutôt en bicarbonate de calcium.
Dès lors, le bicarbonate de calcium perd tous les inconvénients liés au calcaire. Il ne sait plus s’accrocher, il est facile à nettoyer et n’irrite pas la peau. De plus, après l’adoucissement de l’eau au CO2, elle conserve son goût et ses propriétés minérales et ne présente aucun danger pour la santé.
Avec l’adoucisseur d’eau au CO2, il n’y a pas de surconsommation d’eau. De plus, il n’agresse pas les tuyaux, car il élimine les dépôts de calcaire au niveau des canalisations et des appareils.
Quelle solution choisir ?
Un adoucisseur d’eau sans sel utilise uniquement du CO2 alimentaire pour filtrer l’eau. Il ne nécessite pas de processus de régénération ni de sels pour fonctionner. Étant donné qu’il n’utilise que le CO2 pour adoucir l’eau, il n’y a pas de gaspillage et cela ne provoque pas de pollutions. C’est une solution écologique et économique, car ce système ne fonctionne qu’avec un gaz alimentaire qu’il faut simplement remplacer lorsque la bouteille est vide.
Pour mieux choisir l’adoucisseur d’eau qui vous convient le mieux, il faudra vous poser ces quelques questions :
- Quelle est la dureté de votre eau ?
- Combien d’arrivées d’eau disposez-vous ?
- Quel entretien nécessite chaque solution ?
- Quel est votre budget ?
Si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone et faire des économies d’énergie, il est préférable d’opter pour un adoucisseur d’eau au CO2 comme le SoluCalc. Par contre, si vous êtes prêt à effectuer fréquemment des recharges pour entretenir votre système, vous pouvez opter pour l’adoucisseur d’eau au sel.
Compléments pratiques avant et après l’installation
Avant toute pose, il est recommandé de réaliser une analyse de l’eau approfondie (mesure du pH, de la conductivité, du taux de sédiments et de la turbidité) pour établir une cartographie précise des nuisances (entartrage, biofilm, matières en suspension). Ces données orientent vers des solutions adaptées : ajout d’une étape de microfiltration, utilisation d’une préfiltration granulométrique ou même la mise en place d’une unité d’osmose inverse en amont si la qualité le nécessite. L’examen des paramètres ioniques et de la conductivité permet aussi d’évaluer les interactions possibles avec des technologies alternatives (ionisation, champs magnétiques) et d’anticiper les risques de colmatage ou de corrosion. Un diagnostic technique complet inclut également l’analyse granulométrique, la vérification des débits disponibles et la prédiction du temps de contact nécessaire pour obtenir un effet optimal sans altérer la potabilité de l’eau.
Sur le plan opérationnel, pensez à dimensionner correctement l’installation en tenant compte de l’équilibrage hydraulique, des pertes de charge et de la présence d’une vanne by‑pass pour isoler facilement l’équipement. Prévoyez des capteurs de suivi (capteurs de conductivité, pressostats) et un plan de maintenance préventive incluant des contrôles bactériologiques réguliers, le remplacement programmé des cartouches filtrantes et l’inspection des réseaux pour limiter l’incrustation et la formation de biofilm. L’approche doit intégrer le coût total de possession (consommables, main-d’œuvre, consommation énergétique) et des critères d’éco-conception pour réduire l’impact environnemental. Enfin, renseignez-vous sur les filières de recyclage des consommables et consultez des guides pratiques et des retours d’expérience pour valider la solution choisie ; pour des ressources et fiches techniques, visitez le site web In et Out.